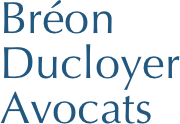Quand une incongruité jurisprudentielle questionne le régime d’occupation domaniale des réseaux et infrastructures publics de communications électroniques
Il est de ces décisions dont on ne sait comment les recevoir en l’absence de postérité, de conclusions disponibles ou même simplement de commentaires éclairés. Alors sagement le juriste les lira avec curiosité, les insèrera par prudence dans ses analyses, tout en recommandant une juste distance avec les solutions retenues, espérant secrètement qu’elles ne constitueront pas la première brique d’une retournement jurisprudentiel retentissant.
Ainsi en va-t-il de la décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 13 février 2024 dans une affaire opposant la société Orange contre Toulouse métropole (n° 2000527).
Cette décision s’inscrit dans une grande histoire juridique, méconnue du grand public, mais ô combien passionnante tant elle se situe à la croisée des chemins entre droit, histoire, économie et politique. En effet, loin des regards, un combat à fleurets mouchetés se joue depuis de nombreuses années entre l’opérateur Orange et de nombreuses collectivités.
Les origines du mal
L’opérateur Orange (ex-France Télécom) s’est longtemps défendu contre les titres exécutoires émis par des collectivités pour les redevances qu’elles estimaient dues par l’opérateur dont les réseaux de communications électroniques occupaient les infrastructures de génie civil situées sous le domaine public. Orange a systématiquement contesté les montants réclamés par ces collectivités, s’élevant parfois à plusieurs millions d’euros, en y opposant son droit de propriété sur celles de ces infrastructures réalisées à l’époque où France Télécom détenait le monopole pour l’établissement des réseaux et infrastructures de télécommunications.
On se rappelle que de l’invention du téléphone, en 1876, à la nationalisation de la société française du téléphone en 1889, le développement du réseau téléphonique est pris en charge par des sociétés privées avec l’autorisation de l’Etat. Le ministère des postes et télégraphes, les fameux « PTT », créé en 1879, prend en charge la poursuite du déploiement du réseau de téléphonie. En pratique, l’Etat détient alors le monopole des réseaux et services de télécommunications ouverts au public. Dans les faits, l’ensemble des réseaux en question relève donc de la propriété de l’Etat.
La direction générale des télécommunications, dénommée ensuite France Télécom, a la charge de la gestion de ces réseaux. Elle se voit attribuer une personnalité juridique par la loi du 2 juillet 1990. A compter du 1er janvier 1991, France Télécom devient ainsi un établissement public industriel et commercial, répondant au statut d’exploitant public. L’ensemble des biens appartenant à l’Etat nécessaires à sa mission lui sont alors transférés de plein droit et à titre gratuit en application de l’article 22 de la loi du 2 juillet 1990.
Une loi du 26 juillet 1996 transforme le statut de France Télécom, qui devient une société anonyme à compter du 31 décembre 1996, demeurant néanmoins sous le contrôle de l’Etat (loi n° 96-660). Ce changement de statut entraîne le transfert des biens de l’exploitant public vers l’entreprise nationale France Télécom, et le déclassement de l’ensemble de ses biens relevant du domaine public. Une autre loi du 26 juillet 1996 met concomitamment fin au monopole de France Télécom pour l’établissement et l’exploitation de réseaux ouverts au public à compter du 1er juillet 1996 (loi n° 96-659).
A compter du 31 décembre 1996, la société France Télécom est donc devenue propriétaire de l’ensemble des réseaux appartenant initialement à l’Etat.
La loi du 31 décembre 2003 autorisant la privatisation de France Télécom a permis son transfert au secteur privé et son changement de dénomination. France Télécom est devenue « Orange » à la suite d’un vote en assemblée générale le 1er juillet 2013.
Ces changements de statuts successifs et la difficulté à recenser de manière précise les infrastructures dont la propriété a été transférée de l’Etat à France Télécom – devenue Orange – ont créé une incertitude concernant l’identité du propriétaire de nombreuses infrastructures de communications électroniques. Or, la question n’est pas sans conséquence : outre la question de la responsabilité de leur entretien (stratégique, comme nous l’évoquerons dans un autre billet), si les infrastructures sont la propriété d’Orange, l’opérateur peut alors les occuper librement. Dans le cas contraire, Orange doit s’acquitter d’une redevance auprès du gestionnaire du domaine occupé.
Le Conseil d’Etat n’a que très récemment défini la grille d’analyse permettant de répondre à cette question. Dans sa décision Société Orange du 18 mars 2024 (n° 470162), la Haute Juridiction a établi l’existence d’une présomption simple de propriété des infrastructures de génie civil établies avant le 1er juillet 1996 (fin du monopole) au bénéfice de France Télécom, devenue Orange. Pour les infrastructures établies à compter du 1er juillet 1996, cette présomption n’a plus lieu d’être : la preuve de la propriété doit être apportée par tous moyens, ce qui implique d’examiner les modalités de création, de gestion et de financement des infrastructures de génie civil au cas par cas.
Cette épopée juridique constitue la toile de fond sur laquelle s’inscrit la décision rendue par le Tribunal administratif de Toulouse le 13 février 2024.
La menace fantôme
Toulouse métropole avait signé avec Orange une convention cadre portant sur la mise à disposition d’infrastructures de génie civil d’accueil de réseaux de communications électroniques dans des ZAC. Cette convention cadre était déclinée en conventions particulières pour les ZAC créées après 1997. Aucun accord n’avait été trouvé pour les ZAC créées avant 1997, les parties ne s’accordant par sur le véritable propriétaire des infrastructures concernées.
Toulouse métropole n’en avait pas moins émis des titres exécutoires à l’encontre d’Orange pour un montant total de plus de six millions d’euros hors taxes. Le problème était ainsi loin d’être théorique.
Saisi par Orange d’une demande d’annulation des titres exécutoires et de la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, le juge toulousain s’est penché sur les conditions de réalisation des infrastructures de chaque ZAC afin d’en identifier le propriétaire grâce au faisceau d’indices portés à sa connaissance par chaque partie.
Une fois la question de la propriété des infrastructures tranchée, le juge s’est penché sur le montant des redevances dont le principe avait été reconnu fondé en droit.
On se rappelle qu’en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (le « CG3P »), l’occupation du domaine public implique le paiement d’une redevance. Celle-ci doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant selon les termes de l’article L. 2125-3 du CG3P.
Ce régime d’occupation domaniale s’applique à l’utilisation des installations de génie civil sur le domaine public permettant le déploiement ultérieur des câbles de communications électroniques à proprement parler, comme l’a implicitement confirmé le juge à l’occasion des multiples litiges entre Orange et les collectivités afin de déterminer le propriétaire de ces installations.
D’autre part, le code des postes et communications électroniques (le « CPCE ») prévoit un régime spécial d’occupation du domaine public en faveur des opérateurs de communications électroniques. Les opérateurs bénéficient ainsi d’un droit de passage sur le domaine public routier (art. L. 45-9 du CPCE) et d’un droit d’occupation sur les autres dépendances du domaine public et réseaux publics, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques (art. L. 46 du CPCE) dont l’occupation relève donc en principe du régime général défini par le CG3P.
La détermination du régime d’occupation applicable n’est pas anodine : le montant de la redevance d’occupation fondée sur le CPCE est plafonné (art. R. 20-52 du CPCE), ce qui n’est pas le cas de celle fondée sur le CG3P.
Les multiples jurisprudences rendues par le juge administratif dans le cadre des litiges opposant Orange aux collectivités sur la propriété des installations de génie civil ne se prononcent jamais explicitement sur le fondement de la redevance appliquée. Toutefois, comme souligné précédemment, le juge a implicitement confirmé l’application du CG3P en ne remettant pas en cause les redevances déterminées sur ce fondement.
Pour sa part, le juge toulousain a – de manière inédite, donc surprenante – retenu le fondement de l’article L. 46 du CPCE pour apprécier le montant des redevances dont le paiement était réclamé à Orange. On peut voir là sans doute un travail efficace du conseil d’Orange, ayant convaincu le juge de faire application du régime du CPCE, plus favorable envers l’occupant en raison du plafond de la redevance qu’il prévoit.
Ce succès reste toutefois étrangement infructueux : le juge ne semble faire aucun cas de l’existence du plafond prévu par l’article L. 46 du CPCE et apprécie le montant des redevances réclamées par Toulouse métropole à l’aune exclusive des avantages de toute nature procurés à l’opérateur par l’occupation des installations.
L’intention du juge toulousain est difficile à décrypter : le régime spécial d’occupation défini par le CPCE exclut bien explicitement de son champ d’application les réseaux et infrastructures publics de communications électroniques. Il est vrai toutefois que la rédaction imprécise des articles L. 45-9 et L. 46 du CPCE peut laisser place à une certaine incertitude (que les travaux parlementaires ne lèvent que partiellement).
Toutefois, tant la pratique que les courants jurisprudentiels confirment l’application du régime général d’occupation domaniale du CG3P aux réseaux et infrastructures publics de communications électroniques. Donc d’une redevance sans plafond.
La décision du juge toulousain n’a pas fait l’objet d’un appel, confirmé par un certificat en bonne et due forme. Sans doute les parties ont-elles trouvé un accord face à une décision qui aurait pu être attaquée tant par Orange que Toulouse métropole.
En tout état de cause, l’absence de postérité de cette décision pour le moins étrange a éloigné – pour l’heure - le spectre (ou l’heureuse perspective, selon les points de vue) d’une redevance plafonnée pour l’utilisation des réseaux et infrastructures publics de communications électroniques.
La question des conditions de l’accès aux infrastructures de génie civil pour le déploiement des réseaux de communications électroniques promet toutefois de nouveaux développements, tant le déploiement de la fibre devient un enjeu crucial dont la pleine et entière réalisation se heurte à des obstacles aussi concrets que le mauvais état des infrastructures permettant son raccordement final.
To be continued.
Julie de Bréon